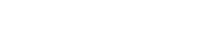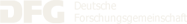En lisant votre Mémoire concernant la littérature sanscrite en Angleterre1, j’ai éprouvé, je l’avoue, une sensation pénible. Depuis nombre d’années j’avais eu l’avantage d’entretenir avec vous des relations littéraires. Je m’étais mis en devoir de vous envoyer tout ce que je publiais en fait de littérature sanscrite, et de votre côté, vous m’aviez fait l’honneur de citer quelquefois ma Bibliothèque Indienne. J’ai consacré dans cet ouvrage périodique un article fort étendu à votre Dictionnaire, et si j’ai été conduit à le critiquer sous quelques rapports, je l’ai fait, j’espère, avec tous les égards que les savans se doivent mutuellement. Tout à coup je me vois attaqué par vous, et avec une hostilité des plus acharnées. Toutefois, j’ai trouvé un adoucissement à mon chagrin dans la généralité de votre sentence de condamnation. Je me vois au moins en bonne compagnie: enveloppé dans la même disgrace avec MM. de Chézy, Bopp, W. de Humboldt, Eugène Burnouf, Lassen, Rosen, Loiseleur Deslongchamps, Rückert, Ewald, etc., je partage volontiers le sort de tant d’hommes de mérite. Vous déclarez que tous les Indianistes du Continent sont des ignorans, qui connaissent à peine les rudiments de la grammaire; et ce qui est pire, que ce sont des ignorans présomptueux, qui, n’étant que des écoliers, se sont érigés en maîtres et ont entrepris des travaux au-dessus de leurs forces. Vous ne leur faites pas ce dernier reproche expressément, mais c’est la conséquence immédiate de votre assertion.
La plus grande franchise dans les jugemens littéraires est non seulement de droit, elle est fort avantageuse aux progrès des sciences. Néanmoins, lorsqu’on croit devoir prononcer une sentence rigoureuse, il paraît équitable de la motiver, et de la faire précéder d’un examen détaillé. C’est particulièrement le cas, quand il s’agit d’un genre d’érudition cultivé par un très-petit nombre de personnes, où par conséquent la masse des lecteurs peut se laisser imposer par l’autorité d’un nom. Vous ne vous êtes pas borné à blâmer tel ou tel ouvrage; vous dépréciez indistinctement tous les travaux des Indianistes du Continent; encore votre dédain ne s’arrête pas là: il s’adresse directement aux auteurs de ces travaux. Vous prononcez vos arrêts comme du haut du trépied, et jamais oracle plus foudroyant n’est sorti même de la grotte souterraine de Trophonius.
Vous direz peut-être, Monsieur, que l’on n’est pas en droit de vous demander compte d’une lettre confidentielle. Mais votre Mémoire était destiné à être mis sous les yeux de tous les membres de la Convocation d’Oxford; le feu Evêque de Calcutta a recommandé de le faire circuler le plus largement possible. Ce Mémoire doit donc être considéré comme un imprimé, livré au public; et en lui donnant une plus grande publicité par ma réimpression’, je ne crois pas commettre une indiscrétion. Je ne veux point supposer que votre intention ait été de donner aux membres de cette célèbre Université une idée défavorable des Indianistes du Continent, sans que ceux-ci, dont la réputation y périclite, en eussent rien appris. Ce serait faire tort à votre délicatesse.
Les statuts de l’ordre de Marie Thérèse portent qu’un militaire qui veut devenir chevalier, doit citer ses faits d’armes, et produire des témoins. Je vois que le même usage est établi à l’égard des candidats qui ambitionnent une chaire à Oxford. Pour un savant modeste c’est assurément une fâcheuse nécessité de devoir parler de soi, et vanter ou faire vanter son propre mérite. Mais dans votre position, Monsieur, ne pouviez vous pas éviter de le faire aux dépens d’autrui? Il me semble que vos titres étaient assez valables sans cela. Tout cet alinéa qui nous concerne, est un épisode, un hors-d’œuvre dans un projet d’enseignement. Vous commencez par poser en principe que c’est une qualité indispensable dans le premier professeur de langue sanscrite, d’en avoir acquis la connaissance dans l’Inde. N’aurait-il pas été à propos de placer ici en marge un signe typographique, usité dans les vieux livres, et servant à diriger l’attention vers un point principal, c’est à dire, une petite main avec le doigt indicateur étendu? Que de concurrens exclus par l’admission de votre principe! Vous avez craint apparemment que les électeurs pourraient bien appeler à cette chaire quelque étranger. Sous ce rapport vous pouviez être tranquille. Pour ma part, je puis vous assurer qu’on n’a pas pensé à moi, et que je n’y ai pas pensé non plus. Si j’avais pu avoir quelque influence sur cette élection, je l’aurais employée tout entière en faveur de M. Haughton, par les motifs développés dans une lettre que je lui ai adressée, et qu’il a fait imprimer parmi tant d’autres témoignages honorables que des savants distingués lui ont donnés.
Le reste de cet alinéa est destiné à prouver votre principe; mais la démonstration est peu satisfaisante. Quand même on vous accorderait que tous les Indianistes du Continent actuellement existans „sont incapables de communiquer des notions complètes et exactes de la littérature classique des Hindous, de leur poésie, de leur mythologie, et de leur science,“ s’ensuit-il qu’un Anglais, un Français ou un Allemand ne puisse pas acquérir ces connaissances sans quitter l’Europe? Cela aurait pu se soutenir il y a trente ans, mais aujourd’hui tout est changé. Les livres imprimés où l’on peut puiser une partie de ces connaissances, sont à notre disposition; il existe aussi à Londres et à Paris de riches dépôts de manuscrits; la seule chose dont il faille se passer, quand on n’a pas de vocation pour aller aux grandes Indes, ce sont les leçons des savants indigènes. Or, quelque utiles que puissent être, sous plusieurs rapports, leurs communications orales, on sait de reste qu’il faut les recevoir avec une grande circonspection. Dès qu’il s’agit de s’élever à des considérations générales, et d’assigner à l’Inde ancienne sa place dans une histoire philosophique du genre humain, nous ne consulterons plus les Pandits, parce que les points de comparaison leur manquent. Le siège de la critique historique et philologique est en Europe; nous avons vu des exemples qu’on la perd facilement de vue en Asie. Feu M. Alexandre Hamilton, qui fut en effet le premier professeur de langue sanscrite en Angleterre, remplissait la condition d’avoir acquis ses connaissances dans l’Inde. Il en possédait d’assez étendues en fait de bibliographie, comme le prouve son catalogue de la Bibliothèque royale à Paris. Mais son édition du Hitôpadêsa et son analyse des premières pages de ce livre, décèlent sa faiblesse dans la partie élémentaire, que vous dédaignez si fort, et qui est pourtant la base de tout le reste.
Puisque vous m’avez fait l’honneur de parler de mes travaux, permettez-moi d’en dire aussi quelques mots de mon côté. Vous dites „que je ne me suis pas hasardé à rien traduire qui n’eût été traduit auparavant par des savants anglais.“ – Par ma Comparaison de quelques passages du Hitôpadêsa dans les deux traductions existantes (voyez l’Appendice sous la lettre D), vous pourrez vous convaincre que je me hasarde à traduire tout autrement que mes prédécesseurs, et des prédécesseurs célèbres, ce qui, à mon avis, est bien plus aventureux que de traduire ce qui ne l’a point encore été. – Au reste je suis très-disposé, Monsieur, à profiter des lumières de mes devanciers. Dans une entreprise ardue l’on ne saurait s’entourer de trop de secours. Je n’ai pas eu la prétention de mettre au jour quelque chose d’entièrement neuf, et de passer d’abord aux problèmes les plus abstrus de la littérature sanscrite. J’ai pensé qu’il fallait marcher pas à pas, et que ce qu’il y avait de plus utile à faire pour le moment, c’était de donner des éditions correctes de quelques ouvrages importans et fondamentaux, qui cependant ne fussent pas trop difficiles. J’ai choisi à cet effet la Bhagavad-Gîtâ, le Râmâyana et le Hitôpadêsa. Jusqu’ici je n’ai pu faire paraître que ma traduction du premier de ces livres. Dans la préface j’ai rendu justice à celle de M. Wilkins. Mais à parler exactement, ce poème si remarquable était-il traduit en entier? M. Wilkins avait laissé en sanscrit beaucoup de termes de métaphysique, que j’ai essayé de rendre en latin. Mon attention était dirigée principalement vers la correction du texte. J’ai corrigé, d’après les manuscrits, les fautes de l’édition de Calcutta qui sont au nombre de plus de soixante dans un poème de sept cents distiques. Il m’est échappé aussi quelques erreurs: je les corrigerai dans une seconde édition que je prépare. Heureusement le texte de ce livre révéré ayant été conservé avec des soins scrupuleux, est d’une rare pureté et authenticité; il n’y avait pas lieu à la critique conjecturale. Un seul passage à la fin du poème m’a paru exiger une émendation. M. Bopp, dans le Journal des Savans de Gœttingue, en réconnut d’abord la justesse. La corruption est si ancienne que le commentateur Srîdhara-Svâmin a déjà eu sous les yeux la leçon vicieuse, qu’il s’efforce vainement de justifier. La plupart des manuscrits la donnent également. J’ai cependant retrouvé mon émendation dans deux manuscrits, dont l’un, provenant du Népal, est conservé dans la bibliothèque de la Compagnie des Indes Orientales, l’autre est en ma possession. Vous pourrez voir quelques autres exemples de conjectures autorisées par des manuscrits, dans les notes que M. Haughton a jointes à son édition de la Loi de Manou (p. 334, 339 et 340), dans celle de M. Loiseleur Deslongchamps (p. 366) et dans la seconde édition de l’épisode de Nalus par M. Bopp (p. 220). Dans la philologie classique, lorsque des émendations, proposées par conjecture, sont confirmées par des manuscrits collationnés postérieurement, on regarde cela comme une preuve de familiarité avec le génie de la langue et le style des auteurs. N’accorderiez-vous pas la même faveur aux Indianistes?
Apparemment, Monsieur, vous envisagez les devoirs d’un éditeur de textes sanscrits tout autrement que moi. Je pense qu’il faut y appliquer dans toute leur rigueur les principes de la critique philologique. Je ne fais rien imprimer sans l’avoir examiné à plusieurs reprises, avec toute l’attention dont je suis capable; je pèse, pour ainsi dire, chaque mot et chaque syllabe. Je ne néglige aucun manuscrit auquel je puis avoir accès, quoique l’expérience ne m’ait que trop bien appris que la plupart ont été faits par des copistes ignorans, qui ne comprenaient pas ce qu’ils écrivaient. Quelquefois un manuscrit très-fautif fournit un secours inattendu, et la diversité des fautes même peut mettre sur la trace de la vraie leçon. Il y a des corrections tellement évidentes, qu’on peut les mettre hardiment dans le texte; celles qui sont moins sures, peuvent être reservées pour les notes; et quand on n’a rien de plausible à proposer, il faut au moins marquer le passage comme suspect. Dans l’ancienne poésie épique on rencontre parfois des inflexions, des formes dérivatives et des constructions qui semblent être contraires aux règles de la grammaire: mais avant de les rejeter, il faut examiner si ce ne sont pas des licences, des archaïsmes, autorisés par les grammairiens et les scoliastes, sous le nom ârsha, c’est à dire l’usage des anciens sages.
Dans la préface de mon Râmâyana j’ai rendu un compte général de mon travail de critique sur ce poème. Dans le commentaire du Hitôpadêsa que j’ai publié conjointement avec M. Lassen, celui-ci s’est chargé de la tâche laborieuse de citer toutes les variantes, de développer les motifs de notre choix et de nos émendations, enfin d’éclaircir les phrases obscures ou douteuses par des passages parallèles. Il a marqué aussi nos erreurs: nous jouons à jeu découvert. De tels développemens ne seraient pas toujours praticables, mais nous avons pensé qu’il était utile d’en donner une fois l’exemple.
Voilà la route que M. Colebrooke a tracée le premier pour la philologie sanscrite. Parmi vos compatriotes M. Haughton est le seul, à ma connaissance, qui ait marché sur ses traces. Chez les Indianistes du Continent ces principes sont généralement réconnus, quoique l’application n’en soit pas toujours également heureuse.
Vous, au contraire, Monsieur, habitué comme vous l’êtes à commander le travail subalterne des Pandits, vous ne semblez guère avoir médité sur la nécessité de ces minuties; vous les croyez peut-être au dessous de la dignité d’un homme qui, par son vaste savoir, embrasse toute la littérature sanscrite. Quant à moi, j’aimerais mieux passer pour un éplucheur de syllabes, que de gâter par ma négligence des textes importans, de précieux monuments de l’antiquité.
Le seul ouvrage sanscrit, imprimé en entier, qui porte votre nom comme éditeur, est le Mêghadoûta. Mais ici l’original n’est qu’un accessoire de votre imitation libre en vers rimés. Dans vos notes vous relevez le mérite poétique de ce petit morceau gracieux, vous rendez sensible la propriété des images par la description des phénomènes naturels sous le ciel de l’Inde, vous expliquez les allusions géographiques et mythologiques, enfin vous citez des passages analogues des poètes classiques et anglais. Mais vous ne vous êtes pas engagé dans l’analyse de ces constructions tortueuses, de ces longs mots composés, qui peuvent arrêter un lecteur assez exercé. Vous avez procuré une jouissance aux amateurs de la poésie descriptive, mais vous n’avez nullement facilité l’intelligence de l’original. Votre étude du Mêghadoûta n’a pas non plus profité à votre dictionnaire, publié six ans plus tard: beaucoup de termes dont le poète se sert, y sont omis. Vous traduisez (strophe 48) indranîla par saphir. C’est la vraie signification, le nom même l’indique. Comment se fait-il que cette même pierre indranîla, dans votre dictionnaire, soit devenue une éméraude? Vous citez à tort l’autorité de Hémachandra: cette fois-ci votre Pandit a lu bien négligemment le lexicographe.
Le Nuage Messager de Câlidâsa, ayant été l’objet d’une admiration peut-être excessive, a trouvé de nombreux commentateurs, dont vous pouviez consulter les explications. Je présume que le soin de l’impression a été confié à Bâbou-Râma, à ce Pandit, employé autrefois par M. Colebrooke, qui sur le titre de ses éditions se nomme naïvement l’ingénieux Bâbou-Râma. Au moins on y réconnaît son orthographe toute particulière, les mots enchevêtrés par la transformation inutile du visarga en sifflante devant les sifflantes, et de l’anusvâra final en la nasale qui correspond à la consonne suivante. Cependant je vous préviens qu’il s’est glissé, aussi-bien dans le poème que dans les vers sanscrits cités par vous, plusieurs fautes qui ne sont pas indiquées dans l’errata. Deux points de trop dans la seconde ligne de la deuxième strophe dérangent toute une construction. Le vague de votre traduction versifiée ne permet pas toujours de démêler jusqu’à quel point vous avez saisi la pensée du poète; mais les passages en petit nombre que vous avez traduits littéralement en prose, ne sont pas exempts de méprises. Vous dites (p. 44) que le nuage est d’un rouge foncé, par le reflèt des roses de la Chine, abondantes en cette saison. Demandez aux opticiens, si cela est possible. Toutes les roses de Pestum et de la vallée de Jéricho n’y suffiraient pas. Aussi Câlidâsa ne s’est-il pas rendu coupable d’une pareille exagération. Il dit que le nuage reçoit le reflèt du soleil couchant, coloré comme les roses de cette espèce, fraîchement écloses.
sāṃdhyaṃ tejaḥ pratinavajavāpuṣparaktaṃ dadhānaḥ |
C’est un phénomène que les poètes de tous les pays, à commencer par Homère, ont décrit mille fois.
Mais il y aurait des erreurs plus graves dans votre édition, publiée en 1813, que la date les excuserait. Je prendrai pour mesure de votre manière d’entendre la critique et l’interprétation des textes, l’Essai sur l’histoire sanscrite de Cachemire, imprimé en 1825 dans le XV. Vol. des Recherches Asiatiques. Cet ouvrage, dont on doit la première connaissance à l’extrait d’Aboulfazel, avait depuis long-temps attiré l’attention des savans. Quelle qu’en soit la valeur intrinsèque, il est fort curieux, parce qu’il est unique en son genre. La première partie, la Râja-Taringinî (ou plutôt Taranginî?), qui remonte jusqu’aux temps héroïques, et dont l’auteur, écrivant au milieu du douzième siècle de notre ère, assure avoir suivi des autorités plus anciennes, doit être la plus intéressante, et vous auriez rendu un grand service à ceux qui s’occupent de recherches sur l’histoire ancienne de l’Asie, en publiant l’original en entier. Mais vous avez jugé cela impraticable, parce que les trois manuscrits que vous aviez entre vos mains sont tous très-fautifs. Outre ces copies, vous étiez cependant en possession de plusieurs ouvrages persans, contenant des traductions ou des extraits de l’histoire de Cachemire, qui, malgré leur inexactitude, comme vous le remarquez vous même, peuvent quelquefois servir à constater les leçons de l’original. En vous laissant décourager si vite, vous avez manqué une belle occasion de faire briller votre sagacité. C’est précisément le triomphe d’un critique consommé dans son art, de savoir rétablir un texte tolérablement correct avec des matériaux défectueux.
Les vers peu nombreux que vous avez donnés en original, fourmillent en effet de fausses leçons. J’ignore si elles se trouvent toutes dans tous vos manuscrits, ou si elles se sont introduites pendant l’impression exécutée sous vos yeux. La dernière supposition serait encore moins favorable à l’éditeur que la première. Plusieurs de ces fautes sont palpables, et la correction eût été très-facile. Néanmoins vous n’en avez proposé aucune; vous n’avez pas seulement averti vos lecteurs que le passage est corrompu; sans votre déclaration préalable sur la qualité des manuscrits, on pourrait croire que vous ne vous en êtes pas aperçu.
Examinons quelques-uns de ces vers défigurés, et voyons si nous ne pourront pas les rehabiliter jusqu’à un certain point sans le secours des manuscrits. – P. 114:
tasminavasare vauddhvā 'pi prabalitaṃ yayuḥ |
Le n final du pronom devait être doublé, parce qu’il est précédé d’une voyelle brève et suivi d’une autre voyelle; asavara est un mot inouï, il faut transposer les lettres: avasara; le nom des Bouddhistes est doublement corrompu: il y a un va au lieu d’un ba, et dans la seconde syllabe un va de trop. Le second hémistiche n’a que sept syllabes; cela vient de ce que vous avez élidé mal à propos l’A initial de la particule: les règles de la grammaire, aussi bien que celles de la versification, en exigent le rétablissement. prabalitaṃ est au moins un mot suspect, dont il faudrait prouver la réalité par des exemples authentiques. Il faut lire sans doute prabalatāṃ; c’est le substantif abstrait, régulièrement dérivé de l’adjectif prabala qui se trouvé marqué dans votre dictionnaire. Voilà six fautes dans un seul vers, qui doit être lu ainsi:
tasminn avasare bauddhā api prabalatāṃ yayuḥ |
Votre traduction n’est pas exacte: „In that time the Bouddhas maintained the ascendancy.“ Vous n’avez pas saisi la force de la particule; le verbe aussi marque un mouvement, un progrès. L’historien dit: „à cette époque les Bouddhistes parvinrent encore davantage à la supériorité.“
Dans le distique suivant vous avez décliné kriyā au masculin, ce qui est impossible:
kriyān nīlapurāṇoktān acchidann āgamadviṣaḥ
Il faut mettre ou l’accusatif du singulier, ou le véritable accusatif du pluriel:
kriyā nīlapurāṇoktā acchidann āgamadviṣaḥ |
Le concours de voyelles dans la césure qui en résulte, n’a rien d’irrégulier. Il en est comme dans le premier vers, tel que je l’ai rétabli. D’après une règle générale la synalèphe n’a pas lieu, Iorsqu’un visarga a été élagué. P. 110 :
te turuṣkānvayodbhūtā 'pi puṇyāśrayā nṛpāḥ |
śuṣkakṣetrādideśeṣu maṭhacaityādi cakrire ||
prājye rājyakṣaṇe teṣāṃ prāyakaśmīramaṇḍalaṃ |
bhojyam āste savauddhvānāṃ pravrajyorjitatejasāṃ ||
tato bhagavataḥ śākyasiṃhasya puranirvṛte |
asmin sahalokadhātau sārddhaṃ varṣaśataṃ hy agāt ||
vodhisatvaś ca deśe 'sminn ekabhūmīśvaro 'bhūt |
sa ca nāgārjunaḥ śrīmān ṣaḍarhatvanasaṃśrayī ||
Parmi les huit vers cités, il y en a deux de mutilés. Dans le premier il faut rétablir api au lieu de 'pi, par les mêmes raisons qui s’appliquent aux deux passages précédens; dans le septième, où l’élision de l’A initial est régulière, il faut mettre l’imparfait 'bhavat au lieu de l’aoriste 'bhūt. Je crois qu’on peut laisser passer le premier vers du second distique, en admettant que le style de l’auteur n’était pas tout-à-fait classique. Dans le vers suivant, au lieu de sa nous écrirons sma, particule qui communique au présent du verbe précédent la signification du prétérit; et nous rétabliront le nom des Bouddhistes, corrumpu en vauddhvānāṃ au lieu de bauddhānāṃ. Dans le premier vers du troisième distique vous trouvez nécessaire de changer pura en pari. Un prêtre Barmane doit être bon juge des termes théologiques du Bouddhisme; si celui que vous avez consulté n’avait pas rejeté la leçon du texte, j’aurais cru quelle pouvait se soutenir. Parmi les significations de pura vous donnez dans votre Dictionnaire celle de corps; ainsi puranirvṛti serait la délivrance de l’ame du corps terrestre. – „The term puranirvritê should be parinirvritê, the sixth case of parinirvriti.“ Le sixième cas ou le génitif prend un visarga; il fallait donc écrire dans la note et dans le texte parinirvritêh, parinirvṛteḥ: l – Ensuite, comment voulez-vous faire entrer le génitif dans la construction? Elle exige l’ablatif, qui s’employe ici comme l’ablatif latin avec la préposition ab. Dans cette déclinaison en effet ces deux cas ne se distinguent pas par la forme: c’est ce qui vous a fait prendre le change. Le premier hémistiche du vers suivant semble avoir besoin d’un remède que je ne sais pas lui administrer. P. 97.
aṣṭaṣaṣṭyadhikāmavdaśatadvāviṃśatiṃ nṛpāḥ |
apīpalaṃs te kāśmīrān gonardādyāḥ kalau yuge ||
bhārataṃ dvāparāṃte bhūdvārttayeti vimohitāḥ |
kecid etāṃ mṛṣā teṣāṃ kālasaṃkhyāṃ pracakrire ||
labdhādhipatyasaṃkhyānāṃ varṣān saṃkhyāya bhūbhujāṃ |
bhuktāt kālāt kaleḥ śeṣo nāsty evaṃ tadvivarjitāt ||
śateṣu ṣaṭsu sārdheṣu tryadhikeṣu ca bhūtale |
kaler gateṣu varṣāṇām abhavan kurupāṇḍavāḥ ||
laukikebde caturviṃśe śakakālasya sāṃprataṃ |
saptatyātyadhikaṃ yātaṃ sahasaṃ parivatsarāḥ ||
prāyas tṛtīyagonardād ārabhya śaradāntadā |
dve sahasre gate triṃśadadhikañca śatatrayaṃ ||
varṣāṇāṃ dvādaśaśatī ṣaṣṭiḥ ṣaḍbhiś ca saṃyutā |
bhūbhujāṃ kālasaṃkhyāyāṃ taddvāpañcāśato matā ||
ṛkṣādṛśaṃ śatenādvairyātsu citraśikhaṇḍiṣu |
uccāre saṃhitākārairevaṃ dattotra nirṇayaḥ ||
āsanmaghāsu munayaḥ śāsati pṛthvīṃ yudhiṣṭhire nṛpatau |
ṣaḍdvikapaṃcadviyutaḥ śakakālas tasya rājyasya ||
Ce passage est fort important, parce que l’auteur y expose son système chronologique; mais il est assez compliqué. A la fin du troisième distique vous traduisez tadvivarjitāt par: „abandoning that computation.“ Ces mots ne peuvent pas signifier cela; d’ailleurs ce serait un enjambement. Le mot vivarjita qui ne se trouve pas dans votre Dictionnaire, s’emploie souvent de la soustraction. Si on garde l’ablatif, il faut le joindre avec kāla et le pronom se rapporterait à kali. Mais si on le met au nominatif, ce que je crois préférable, tadvivarjitaḥ, il serait l’épithète de śeṣaḥ, et alors on pourrait rapporter le pronom au mot varṣa dans le vers précédent. La construction reste toujours un peu embarrassée.
Je laisse de côté quelques leçons douteuses, et je m’arrête au huitième distique. Le premier hémistiche est défiguré par deux fautes monstrueuses, qu’on peut cependant corriger avec une parfaite certitude. Il faut lire: ṛkṣādṛkṣaṃ śatenābdaiḥ Je ne comprends pas uccāre au commencement du second vers. Vous ne donnez dans votre Dictionnaire que deux significations de ce mot, dont aucune ne peut s’appliquer ici. Puisque les vers suivans sont une citation du fameux Astronome Varâha-Mihira, il est naturel de supposer que l’historien aura nommé le titre de l’ouvrage dont ces vers sont tirés, c’est à dire Vârâhi-Sanhitâ. Ensuite kâra se dit en effet de l’auteur d’un livre, par exemple tîkâ-kâra, commentateur. Mais comme il s’agit ici d’un astronome dont l’autorité est d’un grand poids, le mot âchârya, maître, instituteur, semble être plus convenable. C’est ainsi qu’un astronome grec est appelé yavanâchârya. Le pluriel employé pour un seul auteur ne doit pas nous arrêter: c’est une marque de respect. Je propose donc de lire:
ṛkṣādṛkṣaṃ śatenābdair yātsu citraśikhaṇḍiṣu |
vārāhisaṃhitācāryair evaṃ datto 'tra nirṇayaḥ |
et je traduis: „Puisque la constellation des Sept Sages passe d’une maison lunaire à l’autre en cent ans, l’auteur de la Vârâhi-Sanhitâ donne la confirmation de ce calcul de la manière suivante.“
Les Sept Sages sont, comme l’on sait, les étoiles principales de la grande Ourse. Calhana parle de ce prétendu mouvement, que les anciens astronomes de l’Inde attribuaient à cette constellation, et que M. Colebrooke a discuté à fond.
Vous traduisez: „Confirmation of the date is derivable from the calculation made by astronomical writers of the motion of the seven Rishis, which goes from star to star (i. e. performs a complete revolution) in 100 years.“ Les mots from star to star ne présentent point de sens clair. En effet le mot ricsha signifie aussi en général étoile, constellation; mais ici il est synonyme de nacshatra, maison lunaire. C’est ainsi que Varâha-Mihira l’a employé dans un vers cité par M. Colebrooke, qui contient la même doctrine. Les mots que vous avez mis en parenthèse renferment une erreur matérielle. Puisque, d’après cette théorie, les Sept Sages séjournent cent ans dans chaque maison lunaire, leur révolution ne s’accomplit que dans 2700 ans, et c’est ce que Sâkalya enseigne expressément.
Je remarque en passant, qu’aucun des trois calculs chronologiques dont vous avez fait suivre ce passage, ne s’accorde parfaitement avec les données de Calhana. Cela vient de ce que vous y avez mêlé un élément hétérogène, à l’égard duquel vous n’étes pas d’accord avec vous même. Vous donnez la date de votre dissertation, écrite en 1820; vous la réduisez à l’an du Cali-Youga et à l’an du Sâca 1744. Mais l’an 1820 de notre ère coïncide avec Sâca 1742; et dans la supposition de Calhana, le Cali-Youga aurait commencé 3101 avant J. C.; l’an 1820 serait donc 4919 de cette époque. Rectifiez ces chiffres, et vous verrez qu’il n’y a aucune erreur dans les calculs de l’historien.
Vous vous écartez encore bien avantage de votre auteur dans votre table chronologique p. 81 et 82; mais n’ayant pas le moyen de vérifier les causes de ce désaccord, je reviens à mes observations grammaticales.
L’ouvrage de Calhana étant versifié, je fus surpris de trouver à la page 34 une ligne qui ne peut se reduire à aucune mesure connue:
krūraiḥ vadhakarmādhikāribhiḥ saṃdhimatiḥ śūle samāropya vipāditaḥ |
Ce sont disjecti membra poetae. En transposant le premier mot, j’y ai retrouvé un vers régulier avec le second hémistiche du vers précédent:
— — — — badhakarmādhikāribhiḥ |
kṛūraiḥ saṃdhimatiḥ śūlaṃ samāropya vipāditaḥ ||
P. 20:
athāvahad aśokākhyaḥ satyasaṃdho vasuṃdharāṃ |
yaḥ śāntavṛjino rājā prapanno jinaśāsanam ||
„Then the prince Asôka, the lover of truth, obtained the earth; who sinning in subdued affections, produced the Jina Sâsana.“ P. 19 vous dites, en vous référant à ce passage: „It appears that this prince did not introduce, but invented or originated the Jina Sâsana.“ Je ne comprends rien à votre traduction. Dites-nous, de grace, comment on pêche en subjuguant ses affections? Les moralistes indiens inculquent au contraire la nécessité de tenir ses sens et ses passions dans la sujétion, pour être en état de remplir ses devoirs. Et que veut dire: „il produisit ou inventa le Jina Sâsana,“ c’est à dire la doctrine de Bouddha? Asôka aurait donc été identique avec le fondateur de cette religion? Jina est donné par Amara-Sinha comme un synonyme de Bouddha, et c’est ainsi qu’il doit s’entendre à cette époque de l’histoire. La secte moderne des Jaïnas à hérité des Bouddhistes même son nom. D’ou viennent ces contresens? De l’oubli de la grammaire. Le mot composé śāntavṛjinaḥ appartient à la classe Bahuvrîhi, et doit être analysé ainsi: śāntāni vṛjināni yasya saḥ | Comme participe, śānta signifie apaisé, comme adjectif, tranquille, mais il se dit aussi d’un feu éteint. Ensuite vous avez pris le participe passif prapannaḥ dans un sens actif, ce qui est impossible; mais il peut être neutre ou réflêchi. Je traduis donc:
„Ensuite un roi appelé Asôka, loyal dans ses engagemens, gouverna le pays; lequel, ayant effacé ses pêchés, se convertit à la doctrine des Jinas.“
Ce distique est parfaitement correct, et ne présente aucune difficulté grammaticale; mais j’y vois une grande difficulté historique. Comment cela s’accorde-t-il avec ce que l’historien raconte de ce même prince, qu’il obtint par ses austérités religieuses la faveur de Siva qui lui accorda un fils, destiné à chasser les Barbares? Et si Calhana professait le culte brahmanique, comment pouvait-il louer la sainteté d’un prince apostat? Ou s’était-il fait une loi de l’impartialité historique? – On pourrait soupçonner que le texte eût été falsifié à dessein, et qu’un adhérent de la secte des Jinas eût substitué ce mot à un autre qui exprimait la foi orthodoxe, par exemple Sruti. Cependant Aboulfazel a déjà lu la même chose dans la traduction persanne, faite par ordre de l’empereur Acbar2.
Dans le distique suivant:
mlecchaiḥ saṃchādite deśe sa taducchittaye nṛpaḥ |
tapaḥsaṃtoṣitāl lebhe bhūteśāt sukṛtīsutaṃ ||
vous avez pris les dernières cinq syllabes pour un mot composé, en traduisant: an excellent son. Cela serait contraire aux règles de la composition, trop connues pour qu’il soit nécessaire de les rappeler ici. Il faut détacher les mots, et appliquer l’épithète au père.
P. 21:
vodhisattvaikaśaraṇāḥ kāṃkṣaṃtyas tamasaḥ kṣayaṃ |
loke bhagavato lokanāthād ārabhya kecana ||
ye jantava gatakleśān vodhisattvāvavedi tān |
sāgase 'pi na kupyaṃti kṣamayā copakurvate ||
vodhiṃ svasyaiva yeṣyanti te viśvadharaṇodyatāḥ |
Le participe féminin kāṃkṣaṃtyaḥ doit être mis au masculin: kāṃkṣaṃtaḥ le visarga de jantavaḥ au lieu d’être élagué, doit être transformé. Je ne vois pas par quoi pourraient être régis les deux accusatifs suivans, et je pense qu’il faut les changer en nominatifs. La dernière syllabe de ce vers est mal à propos détachée des précédentes, avec lesquelles elle ne forme qu’un seul mot. Dans le cinquième vers yeṣyanti n’est point une forme légitime: il faut mettre yeṣante. Voyez votre dictionnaire sous l’article yeṣ.
„Those who are Bodhisatwas trusting to the one great refuge, are desirous of the destruction of darkness; they proceed in the universe of the Lord, from the Lord of the universe, and are not wroth sinfully at the distresses inflicted on animal nature unpervaded by waking truth, but alleviate them by patience. Those who seek to understand themselves, they are strenuous in bearing all.“
Cette traduction est en partie fausse, en partie inintelligible. Vous avez pris le premier mot pour un dvandva ou composé agrégatif, et c’est un tatpurusha qu’il faut analyser ainsi: bodhisatve ou bodhisattveṣvekaṃ śaraṇaṃ yeṣāṃ te | Vous traduisez l’absolutif ārabhya par: they proceed; il signifie à commencer par. D’où avez vous pris les souffrances de la nature animale? gatakleśa signifie au contraire celui dont les souffirances sont passées. Vous prenez avavedita dans un sens négatif. Je ne me rappelle pas d’avoir jamais rencontré ce mot dans un auteur brahmanique; probablement il appartient au style des théologiens bouddhistes. La liaison semble exiger un autre sens. Dans le premier hémistiche du quatrième vers vous avez pris sāgase pour un adverbe: sinfully; tandis que c’est un substantif au datif, exprimant l’objet de la colère.
Ces vers sont une exhortation à la tolérance envers les Bouddhistes, adressée au roi Jalôca par une voix céleste. Vous dites que cette divinité qualifia le roi lui-même de Bôdhisatwa. Étant adonné au culte de Siva, il en aurait peut-être été peu flatté; mais dans les vers cités je n’en vois pas la trace. Le terme Bôdhisatwa est bien connu dans tous les pays bouddhistes. Il signifie un successeur, un réprésentant de Bouddha et, d’après les élémens du mot, un Contemplatif parfait. On ne peut traduire qu’en hésitant un passage qui pourrait bien cacher encore d’autres fautes que celles qui sont à la surface. Cependant la teneur générale de ce discours est claire. La divinité dit que les adhérens de Bouddha et de ses successeurs sont des gens fort paisibles, qui ne font du mal à personne, qui supportent même les injures, et sont portés à la vie contemplative. L’on accorde à une voix miraculeuse un peu de galimathias, mais la dose que vous y avez mise est trop forte.
Vous avez cité quelques autres textes, dont vous pouviez sans doute consulter de bons manuscrits; ils n’en sont pas plus corrects. Dans les six vers du Mahâ-Bhârata, cités p. 12, il y a deux fautes d’orthographe. Dans ce vers isolé du même poème:
yadā ciramṛtaḥ pāṇḍu kathaṃ tasya te cāpare |
outre une ou deux fautes d’orthographe, le dernier hémistiche est mal scandé: une syllabe longue est absolument inadmissible dans la cinquième place. De plus, par cette fausse leçon, la particule iti est perdue, qui est nécessaire ici pour marquer la fin d’un discours. On verra cela plus clairement, en mettant ce vers dans sa liaison:
āhuḥ kecinna tasyaite tasyaita iti cāpare |
yadā ciraṃ mṛtaḥ pāṇḍuḥ kathaṃ tasyeti cāpare ||
L’apparition des cinq fils de Pândou dans la capitale, mit le peuple en grand émoi. Les uns disaient: „ce ne sont pas ses fils;“ d’autres: „ils le sont;“ d’autres encore: „comment le seraient-ils, puisque Pândou est mort depuis long-temps?“
Dans cette sentence de Vrihaspati citée à la page 44:
mahāpātakayukto 'pi na vipro badham arhati |
nirvāsanāṃkamauṇḍyaṃ tasya kuryān narādhipaḥ ||
il faut lire à la fin du troisième hémistiche mauṇḍyāni, pour rétablir la versification. Tout cet hémistiche est un composé agrégatif, mis au pluriel, quoique chaque élément doive être entendu au singulier. Le dernier mot manque dans votre dictionnaire.
Si mes observations ne sont pas fondées, il vous sera facile de les réfuter. Mais si elles le sont, je demande, si des textes imprimés avec cette négligence, peuvent nous avancer dans l’étude du sanscrit? Les fautes que j’ai relevées, se trouvent dans 37 vers de la Râja-Taringinî, les seuls que vous ayez cités. Que ferait-on d’une édition complète de ce livre, où les fautes seraient dans la même proportion avec le nombre total des vers? Et quelle confiance peut inspirer un extrait un original aussi mal lu, et aussi mal compris?
Je ne m’occuperai pas pour le moment de la partie historique de votre Essai, quoique j’aye une infinité d’objections à faire contre vos conclusions et vos hypothèses. Mais, à mon avis, rien n’est plus superflu que d’écrire des dissertations, sans avoir sur quoi disserter. Avant tout il faut constater ce que Calhana a effectivement écrit; ensuite il faut nous assurer que nous l’avons bien compris. Si nos moyens actuels n’y suffisent pas, il faut ajourner: on découvrira peut-être de meilleurs manuscrits; il doit en exister en Cachemire. Ce n’est qu’après avoir rempli les deux conditions indiquées, qu’on peut examiner à quel point cet historien est digne de foi; où commence la partie vraiment historique de son recit, c’est-à-dire l’époque depuis laquelle les événements ont été consignés par écrit par des contemporains; si, dans l’époque antérieure, on peut reconnaître quelques faits véritables, déguisés seulement par la fiction et le merveilleux; quel est le rapport des traditions Cachemiriennes avec celles des autres peuples de l’Inde, surtout avec les deux poèmes héroïques, le Râmâyana et le Mahâ-Bhârata; si le récit de Calhana, concernant la propagation du Bouddhisme en Cachemire à différentes époques, s’accorde ou non, avec la chronologie et les annales des Bouddhistes; quels sont les points de contact entre l’histoire de Cachemire et celle des pays voisins, etc. etc. Vous vous étes mis en peine pour réduire le nombre d’années que Calhana assigne à chaque époque et à chaque règne, afin de le mettre d’accord avec la chronologie vulgaire de l’occident, chronologie factice et imaginée par les harmonistes de l’histoire sacrée et profane. C’était, selon moi, une œuvre surérogatoire. Après tant de vains essais de faire entrer les traditions divergentes des anciens peuples dans ce lit de Procruste, on devrait à la fin s’en désister. De tels systèmes sont des toiles d’araignée, qu’un bon coup de balai de la critique historique enlève en un instant. Mais quand je vois que vous prenez le chapitre en tête du Mahâ-Bhârata, intitulé Anukramanikâ, c’est-à-dire Sommaire, Table des matières, pour le vrai poème original, et tout le reste pour une amplification postérieure3; que vous nous faites venir le premier Bouddha de la Tartarie4, et autres hypothèses semblables: je désespère que nous puissions jamais nous entendre dans une discussion historique de ce genre.
Vous nous reprochez, Monsieur, de n’avoir qu’une lecture peu étendue dans la littérature sanscrite. J’en conviens volontiers pour ma part. Vous concevez, qu’une manière de lire aussi scrupuleuse ou, si vous voulez, pointilleuse que la mienne, exige du temps. Je pense que pour s’orienter dans une sphère intellectuelle, aussi neuve pour nous, aussi différente de celle où nous avons puisé toutes nos idées, il vaut mieux étudier à fond un petit nombre d’ouvrages importants, les lire et relire sans cesse, que de parcourir superficiellement beaucoup de volumes. Par l’habitude d’esquiver les difficultés, de deviner au lieu d’analyser, et de se contenter d’un à peu près, on court risque de faire entièrement fausse route. D’ailleurs, les richesses de la littérature sanscrite sont si immenses, que la lecture la plus étendue dont un homme laborieux soit capable, ne peut en embrasser qu’une très-petite portion. Même lorsque nous aurons de plus grandes facilités, il faudra que les savans qui la cultivent s’en partagent, pour ainsi dire, les divers départemens.
Dans l’instruction primaire, la méthode analytique mérite non seulement la préférence, mais elle est absolument indispensable. Vous avez senti, Monsieur, que la position d’un professeur de sanscrit est tout autre que celle d’un professeur de grec ou de latin. Celui-ci, n’ayant à faire qu’à des écoliers déjà préparés, peut se borner à montrer l’art de l’interprétation et de la critique, appliqué à quelques auteurs difficiles, et donner son soin principal à des cours de littérature générale, d’antiquités, de mythologie et d’histoire des beaux-arts. Un professeur de sanscrit au contraire doit condescendre à enseigner les premiers élémens, puisque les étudians arrivent à l’université sans avoir eu l’occasion de les apprendre. Il doit les examiner après chaque leçon, comme vous le remarquez fort bien. Mais cela ne suffit pas: aussitôt qu’ils ont compris les principes de la grammaire, qu’on peut simplifier, en laissant d’abord de côté ce qui n’est pas d’une utilité pratique, les écoliers doivent eux-mêmes mettre la main à l’œuvre, en s’exerçant à expliquer un texte avec le secours du dictionnaire et de la grammaire, mais sans se fier à une traduction déjà faite. Il ne faut pas passer outre, avant qu’ils n’ayent su analyser chaque mot et chaque phrase d’après les règles de l’inflexion, de la dérivation, de la composition, et de la syntaxe. Après avoir lu ainsi quelques ouvrages ou portions d’ouvrages, qu’on aura eu soin de choisir selon les différens dégrés de difficulté, ils seront en état de faire leur chemin ultérieur sans le secours d’un maître, pourvu qu’ils ayent du talent et de la persévérance; s’ils n’en ont pas, on fera mieux de leur déconseiller toute cette étude. Voilà la méthode d’après laquelle j’ai enseigné le sanscrit depuis dix ans, et j’ose dire, avec quelque succès.
A l’égard du choix des livres, je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous. Vous nommez le Raghou-Vansa, la loi de Manou, le Râmâyana et le Mahâ-Bhârata. Vous avez interverti l’ordre naturel. Il faut commencer par l’ancienne poésie épique. C’est ce qu’il y a de plus facile et en même temps de plus attrayant. Les constructions sont simples, la narration est coulante et lumineuse. Après avoir purgé ces deux poèmes merveilleux des fausses leçons et des vers interpolés, il y restera encore des nœuds, peut-être quelques-uns d’insolubles, puisque les scoliastes ont déjà tâtonné. Mais ces passages sont comparativement peu nombreux. Il en est comme d’Homère qu’on employe avec raison dans les rudiments du grec.
Vous excluez de votre plan le Hitôpadêsa. Je suis de l’avis contraire. M. Colebrooke l’était aussi, puisque c’est d’après ses conseils, que l’édition de Serampore fut faite pour l’usage du Collége de Fort William.
D’abord le Hitôpadêsa nous offre un rare exemple de prose sanscrite. Celle des livres scientifiques est hérissée de difficultés, et ne peut être abordée que plus tard. Ici la prose est simple et animée: elle est toute en récit ou en dialogue. Ensuite ces contes ingénieux sont un tableau vivant des mœurs; rien n’est mieux fait pour donner une idée de la vie sociale dans l’Inde. Les sentences enfin offrent une grande variété de styles, depuis le plus simple jusqu’au plus compliqué; c’est encore un avantage. On peut laisser de côté celles qui paraîtront trop difficiles, sans que cela nuise à la liaison.
Vous ne nommez pas la Bhagavad-Gîtâ. Elle est cependant tellement à part du reste du Mâha-Bhârata, qu’elle peut à peine être comprise sous ce nom général. Ce livre sublime contient de la métaphysique, mais la manière dont elle y est enseignée, respire la simplicité grandiose du siècle épique.
La loi de Manou est un livre fondamental, mais la lecture en est austère. Le laconisme du style législatif cause de l’obscurité; une seule sentence exige quelquefois de longues explications. En revanche, lorsqu’un étudiant du sanscrit se sera bien pénétré de l’esprit de cette législation, et qu’il en aura imprimé les détails dans sa mémoire, il possédera la clé de tout le reste.
Vous accordez dans votre plan une place au Raghou-Vansa. Je ne sais pas s’il la mérite. Je n’ai pas encore eu l’occasion de lire ce poème en entier; mais le morceau qu’en a publié M. Loiseleur-Deslongchamps, la mort du jeune hermite, est bien froid et bien sec, à côté de la manière dont ce sujet a été traité par Vâlmîki. Ce même récit, mis dans la bouche de Dasaratha mourant, produit un effet irrésistible. Dans le genre pathétique, je ne connais en aucune langue rien de supérieur à ce morceau du Râmâyana.
En général, je ne partage pas entiérement l’admiration des littérateurs modernes de l’Inde pour les six grands poèmes. Il y a, en effet, un étonnant artifice dans la diction: c’est un tissu aussi subtil que des dentelles. Ce sont des jeux d’esprit qui ne parlent pas à l’ame. Les poètes, à mon avis, ont abusé de la merveilleuse flexibilité de leur langue, surtout de la facilité de former des mots composés. Leurs ouvrages ont été appréciés d’après le principe de la difficulté vaincue; leur lecture aussi offre beaucoup de difficultés: mais je doute qu’il vaille la peine de les vaincre.
Si l’on veut étendre le cours académique à des livres plus difficiles, je recommanderai plutôt la poésie sentencieuse dont les énigmes sont courtes et renferment un fonds de pensée: par exemple les sentences de Bhartri-Hari; ou la poésie dramatique, surtout cette ravissante Sacontalâ, le plus parfait parmi les drames indiens jusqu’ici connus.
En passant en revue les éditions des livres sanscrits que vous jugez propres à être employés dans l’enseignement, vous n’examinez pas, si elles sont correctes ou non, bien ou mal faites; vous vous arrêtez uniquement à leur prix plus ou moins élevé. Je conçois, que le premier soin d’un régent de village doit être de fournir à ses petits élèves rustiques des exemplaires de l’Abecedaire et du Catéchisme à bon marché. Mais quand une nouvelle chaire a été fondée pour un but important, à la magnifique université d’Oxford, dans la riche Angleterre, cette considération me paraît on ne peut pas plus mesquine. Je l’avoue, j’ai ri de bon cœur de vos doléances sur la cherté de mon Râmâyana. Eh, Monsieur, si je n’avais pas honte de parler des sacrifices pécuniaires que j’ai faits pour faciliter l’étude du sanscrit, je vous dirais, qu’il est bien plus dispendieux de faire imprimer à ses frais, outre les dépenses occasionnées par les travaux préparatoires, un ouvrage volumineux, avec l’exécution typographique la plus soignée, que d’en acheter un exemplaire. Je n’ai pas pensé à faire un livre d’école; j’ai voulu présenter à l’Europe savante un monument vénérable de l’antiquité, sous un extérieur conforme à sa dignité.
Chaque étude exige certains moyens: ceux qui ne les ont pas doivent s’en désister, à moins que l’état n’y pourvoye dans son propre intérêt. La Grammaire de M. Wilkins est chère aussi; votre Dictionnaire est plus cher encore: cependant vos élèves ne pourront faire aucun progrès sans avoir ces livres, qu’ils doivent consulter à chaque instant. En général, par des raisons fort simples, les livres imprimés en entier ou en partie dans les caractères originaux des langues asiatiques, sont plus chers que ceux où l’on n’employe que nos caractères ordinaires. Vous pourrez vous en convaincre, en parcourant le Catalogue publié annuellement par les librairies de la Compagnie des Indes. Néanmoins les ouvrages du premier genre, exécutés en France ou en Allemagne, se vendent à un prix comparativement plus modique que ceux qu’on imprime en Angleterre. Vous remarquez que les livres sanscrits imprimés à Calcutta, pourraient être fournis à un prix raisonnable, si le droit d’importation ne les renchérissait pas. Cet impôt barbare sur les livres étrangers, qui existe encore en Angleterre, s’étend donc aussi aux livres imprimés dans l’empire britannique en Asie? C’est un fait curieux à connaître.
Mais laissons là ces détails de ménage, pour nous occuper de la qualité des éditions. Vous ne faites pas mention de celles de Serampore, quoique le Hitôpadêsa et deux volumes du Râmâyana (le Ier et le IIIème) se trouvent encore dans la librairie. Vous semblez avoir senti qu’elles sont trop fautives pour entrer en ligne de compte. J’ai caractérisé les éditions de Calcutta dans ma lettre à Sir James Mackintosh. Mais à part leurs inconvéniens, le choix des ouvrages a été tel, qu’on ne saurait les employer dans un cours élémentaire. Quand j’ai fait réimprimer la Bhagavad-Gîtâ, la première édition était déjà épuisée. La première édition de la Loi de Manou l’est aussi depuis long-temps. M. Rosen a examiné dans le Journal Asiatique de Londres la seconde, dont le premier volume est nouvellement arrivé en Europe; il a prouvé qu’elle est inférieure pour la correction aux excellentes éditions de MM. Haughton et Loiseleur-Deslongchamps.
Vous nous annoncez un Mahâ-Bhârata complet, entrepris à Calcutta. D’après les morceaux qu’ont fait imprimer MM. Frank, de Chézy et Bopp, j’ai conçu l’opinion que le texte de ce poème a besoin d’un grand travail de critique, principalement pour élaguer les vers interpolés, qui ne sont que des répétitions mal déguisées, et pour remettre à leur place les vers dérangés. Les éditeurs de Calcutta feront-ils ce travail, dont les scoliastes même n’ont pas senti la nécessité? Les savans seront bien aise d’avoir le tout, ne fut ce qu’un manuscrit vulgaire, qui n’aurait fait que passer, peut-être à son détriment, par les mains d’un compositeur et d’un prote. Mais ce poème est trop long pour être expliqué en entier dans un cours académique. M. Bopp fit un choix excellent en publiant l’épisode de Nalus. C’est une composition délicieuse: rien n’est plus propre à donner aux écoliers le goût de la poésie sanscrite. Je regrette seulement que M. Bopp ait introduit dans la seconde édition, corrigée d’ailleurs en plusieurs endroits, sa méthode de séparer ou plutôt de déchirer les mots, qui en rend la lecture très-pénible.
Le Raghou-Vansa, imprimé aux frais du Comité des traductions, va paraître prochainement. Un jeune savant allemand qui a suivi les cours de M. Bopp et les miens, M. Stenzler, s’est chargé de ce travail.
Vous vous proposez d’établir une imprimerie sanscrite à Oxford. Je souhaite sincèrement que ce projet soit réalisé. Vous contribuerez ainsi pour votre part à réfuter le reproche, qu’on a fait trop souvent à cette illustre résidence de l’érudition, qu’elle n’aime pas à élargir sa sphère, et n’est guère favorable aux progrès des lumières. Vous trouverez dans la Bibliothèque Ratcliffienne quelques manuscrits précieux, dont personne n’avait connaissance, et que j’y ai découverts il y a huit ans.
Mais l’établissement d’une imprimerie et sa mise en activité exige du temps. En attendant il faudra vous contenter des livres déjà publiés. Vous verrez qu’à une exception près, les seules éditions qu’on puisse employer avec avantage dans l’enseignement, ont été fournies par les Indianistes du Continent, et vous serez assez équitable pour avouer que vous leur avez quelque obligation.
J’en suis désolé pour vous, Monsieur: si vous n’avez pas commis une injustice, vous avez au moins fait un acte de haute imprudence. Votre réputation vous précédait en Europe; à votre arrivée, vous étiez sûr d’être reçu à bras ouverts par tous ceux qui cultivent les mêmes lettres que vous: car enfin le dictionnaire qui porte votre nom, tel qu’il est, nous a été fort utile à tous. Maintenant tout est changé: la morgue provoque naturellement la censure. Toutefois, ne craignez rien de la part de nous autres vétérans. Nous devons imiter l’impassibilité de ces Brahmanes dont nous admirons les sages maximes. Nous nous rappelons que Visvâmitra perdit tout le fruit de ses pénitences pour s’être laissé entraîner à un mouvement de colére, quoique la provocation fût assez forte. Ma lettre à Sir James Mackintosh était écrite avant que je n’eusse reçu votre déclaration de guerre; cependant je n’ai rien changé à l’article qui vous concerne. Mais je ne vous réponds pas de nos jeunes Indianistes: ils sont aussi fongueux que zélés pour leur étude, et pourraient être tentés de venger leurs anciens maîtres. Si vous publiez quelque ouvrage, on sera à l’affût de vos méprises: et qui n’en commet pas? Si, au contraire, vous ne publiez rien, on dira qu’en partant de Calcutta, vous avez oublié d’embarquer votre savoir. Croyez-moi, faite votre paix le plutôt et le mieux que vous pourrez; je vous offre mes bons offices comme médiateur.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération très-distinguée.
Bonn, au mois de Mai 1832.
A. W. de Schlegel.
1 Voyez l’Appendice sous la lettre F.
2 Dans la traduction de Gladwin (Ayeen Akbery Vol. II, 179) on lit: „Ashowg (Asôka) established, during his reign, the Brahminy rites, and substituted in their stead those of Jyen.“ Comme les deux choses sont contradictoires, established est probablement une faute dʼimpression, au lieu de abolished. Cette traduction de Gladwin est faite avec une telle négligence et incapacité, que rien ne doit nous étonner. Dʼautre part M. Colebrooke ne dit pas un mot de lʼapostasie dʼAsôka. As. Res. Vol. IX, p. 294.
3 Page 12 dans la première note.
4 Page 83 et 84 dans la note. – Parmi les épithètes de Bouddha en langue sanscrite, recueillies dans un livre tibétain, se trouve celle de suvarna-chhavi, de couleur dorée. L’or est jaune, les Tartares sont jaunes: donc Bouddha est venu de la Tartarie. Avec autant de raison on pourrait conclure de l’épithète Homérique χρυσῆ ʼΑφροδίτη, que la Venus des Grecs était de race tartare. Remarquez encore que chhavi ne signifie pas proprement couleur, mais éclat, splendeur. V. Am. Co. L’épithète se rapporte sans doute à l’auréole qu’on donne aux images de Bouddha. Je serais curieux de savoir, où sir W. Jones a pris que les Hindous attribuent à Bouddha un teint entre le blanc et l’incarnat. (As. Res. Vol. II, p. 32.) Je crains bien que ce ne soit une méprise, ou une donnée apocryphe. Selon M. Wilson, les épithètes de Bouddha, tirées d’un vocabulaire chinois, et communiquées par M. Abel-Rémusat, confirment son origine tartare. Ces épithètes, telles qu’elles sont écrites dans les Mines de l’Orient (Vol. IV, p. 187–201) ont besoin de fortes corrections. Rétablies en sanscrit pur, et bien expliquées, elles fournissent au contraire de nouvelles preuves que le législateur religieux, ainsi décrit, n’a pu naître qu’au centre de l’Inde la plus classique.